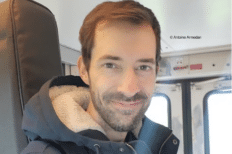Le sacré, selon Thierry Tilquin
Le sacré, selon Thierry Tilquin
Ce 23 octobre, notre collaborateur et ami Thierry Tilquin nous quittait, emporté par l’épidémie. Si, à L’appel, il était journaliste, Thierry était aussi un théologien, à la pensée contemporaine et critique. À sa mémoire, nous republions ici ses réflexions sur le sacré, sur base des textes qu’il avait écrits en 2015 pour L’appel et pour le CEFOC, le Centre de formation en Éducation permanente où il était formateur après en avoir assuré la direction. Merci Thierry.
Publié le
· Mis à jour le
Dans une région d’Afrique centrale, des ingénieurs européens partent en balade au volant de leur 4×4. Au détour d’une piste en terre battue, ils découvrent un large espace couvert de petites pierres blanches qu’ils traversent
allègrement et dont ils font leur terrain de jeu. Sans le sa- voir, ils viennent de profaner un lieu sacré, celui des morts : la terre des ancêtres. C’est l’émoi dans la population. (…) Les ingénieurs devront rentrer au pays.
Quel est le soubassement qui fonde et porte la société moderne européenne ? Quel est le noyau dur sacré, c’est-à- dire ce qui se révèle intouchable et inviolable sous peine de saper les fondements du vivre-ensemble de cette société? Depuis plusieurs siècles, avec le processus de sécularisation, ce n’est plus la religion chrétienne. Celle-ci ne gère plus le sacré. (…) Est-ce la raison, la science, le progrès, la liberté, la démocratie, l’égalité ? Un peu de tout cela, sans doute. La philosophe liégeoise, Gaëlle Jeanmart, qui anime des ateliers de philosophie pour les enfants et les adolescents, explique :
« Avec le déclin des grandes formes collectives de sacralisation, des grandes –˜messes’, le sacré n’a pas disparu, il s’est individualisé. On a chacun ses rites quotidiens, ses habitudes, ses lieux sacrés : notre école, le lieu où l’on a embrassé pour la première fois… C’est une manière de s’humaniser sans doute. Mais avons- nous besoin de ces rites pour être plus humains ? » (…)
SACRÉ PLURIEL
Dans le contexte occidental, le sacré, comme la spiritualité, n’est donc plus l’apanage des religions instituées. Il relève davantage de l’individu. (…) Certains en font l’expérience en se confrontant aux grandes questions de la vie et de la mort, d’autres en communiant avec la foule lors d’un concert, d’autres dans la contemplation d’une oeuvre d’art, d’autres encore dans l’engagement pour une cause commune ou dans la relation amoureuse.
Le sacré n’existe pas en soi, il est ce que l’on sacralise. Il est ce pour quoi on est prêt à se battre, à se sacrifier voire
à donner sa propre vie. En quelque sorte, le sacré s’humanise en se sécularisant. Pour autant, le sacré religieux ne disparaît pas. Il se transforme et évolue en fonction du contexte et de l’histoire. Dans la tradition chrétienne, on a longtemps considéré la Bible comme un texte auquel on ne pouvait toucher et qu’on ne pouvait pas interpréter. Certains de ses livres avaient même été mis à l’index. En s’appuyant sur l’archéologie, les sciences humaines et la philosophie, les exégètes ont mis en lumière le contexte historique dans lequel ont été écrits tous ces textes. Les traductions les ont rendus accessibles aux chrétiens qui, aujourd’hui, peuvent les lire et en faire émerger du sens pour eux-mêmes. (…)
SÉPARATION AVEC LE PROFANE
Au cours de son histoire, l’Église chrétienne n’a pas échappé à la sacralisation. Comme dans les religions anciennes, elle a réintroduit une distinction entre le sacré et le pro- fane. Particulièrement dans la liturgie. Églises, autels et prêtres ont été consacrés. Pour le théologien belge, Joseph Comblin, « le clergé, en tant que classe séparée, est une invention de Constantin (IVe siècle). Jusque-là, il n’y avait pas de distinction entre personne sacrée et personne profane : tous étaient laïcs car Jésus n’avait pas prévu autre chose… Au contraire, il avait mis à l’écart les prêtres et n’avait en aucun cas prévu l’apparition d’une autre classe sacerdotale car tous les hommes sont égaux. Il n’y a pas non plus des personnes sacrées et d’autres non sacrées car, pour Jésus, il n’y a pas de différence entre le sacré et le profane : tout est sacré, tout est profane ». (…)
Cette sacralisation des textes fondateurs, des personnes, des institutions ou encore des espaces et des bâtiments constitue une dominante dans les religions. Ce phénomène peut conduire à des dérives : « Le mot islam, ces trente dernières années, a supplanté Allah, Dieu, explique le philosophe Rachid Benzine. Il y a eu une sorte d’inversion de hiérarchie et aujourd’hui le prophète est en train de supplanter la figure de Dieu. Ce n’est plus Dieu et son prophète mais plutôt le prophète et son Dieu. » L’Église catholique n’est pas en reste : des courants conservateurs y défendent une plus nette séparation entre le clergé et les laïcs ainsi qu’un recentrement autour du culte et de la pratique des sacrements.
LA FRATERNITÉ COMME SACRÉ
N’y aurait-il pas un autre sens du sacré pour aujourd’hui ? Autre que l’exaltation de la liberté de l’individu replié sur lui-même. Autre que la mise à l’écart du monde dans une appartenance religieuse fermée sur elle-même.
Pour Régis Debray, le sacré est au contraire dans ce qui relie les humains entre eux et dans ce qui fait communauté humaine. (…) Pour lui, la sacralité s’incarne dans la fraternité, le troisième terme de la devise républicaine. Qui donne en fait son sens aux deux autres : la liberté et l’égalité. Au-delà des limites de la famille, du clan, de la communauté de sang et de la couleur de peau, c’est « pouvoir appeler frère ou soeur un étranger qui ne porte pas notre nom ». Dans son Plaidoyer pour la fraternité, le philosophe Abdennour Bidar va dans le même sens. « Chacun, écrit-il, va devoir choisir entre la fraternité universelle ou le repli sur soi, la grande famille humaine ou la petite tribu identitaire. » â–
Thierry TILQUIN (– )